Année : 2009
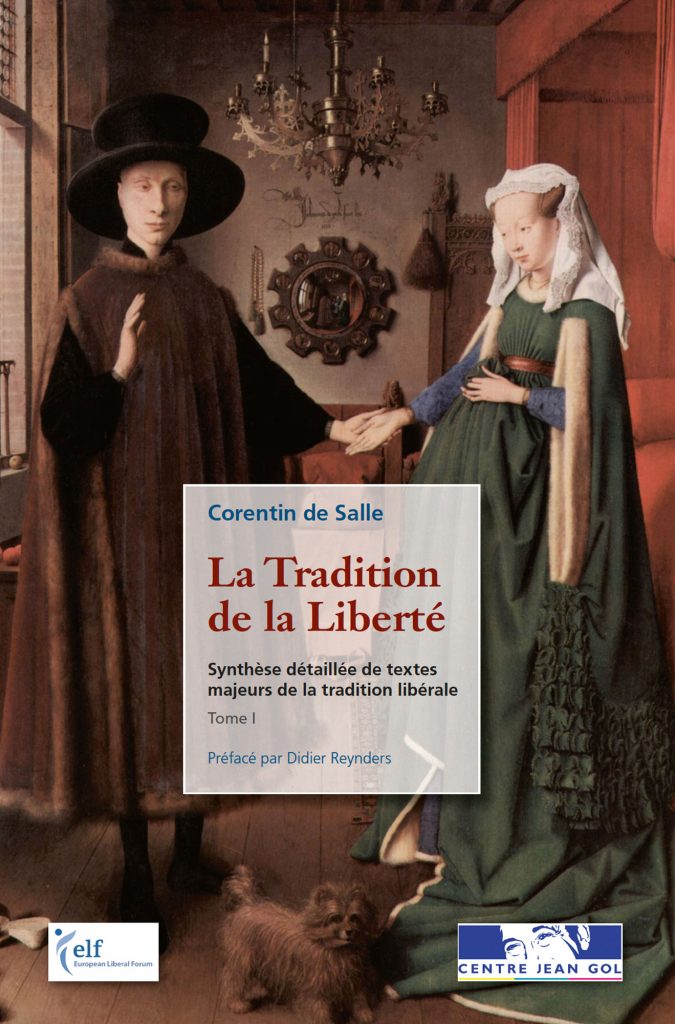 Tout le monde connaît John Locke, Adam Smith, Alexis de Tocqueville, Benjamin Constant, Montesquieu, etc. Mais combien d’entre nous ont lu leurs livres ?
Tout le monde connaît John Locke, Adam Smith, Alexis de Tocqueville, Benjamin Constant, Montesquieu, etc. Mais combien d’entre nous ont lu leurs livres ?
Le livre de Corentin de Salle, dont le premier tome paraît aujourd’hui, entend combler un manque. Certes, les livres sur le libéralisme sont légion mais celui-ci est unique en son genre par rapport à l’offre existante.
Dans celle-ci, on trouve d’abord des ouvrages – dont certains de grande qualité – qui synthétisent les idées des grands auteurs de la tradition libérale dans une perspective chronologique ou thématique. Classiquement, la démarche consiste à extraire les idées principales des divers textes d’un auteur et à présenter un exposé aussi complet que possible de sa doctrine. Cette vue d’ensemble permet de relier les auteurs entre eux et de suivre l’évolution de la pensée libérale à travers les siècles. Cette option méthodologique dessine les grandes tendances, fournit des repères très précieux, mais elle est nécessairement réductrice, généralisante et simplificatrice. Elle n’est pas à l’abri non plus d’un certain nombre de jugements de valeur.
On trouve également des ouvrages consistant à reproduire de copieux extraits tirés directement de l’oeuvre de ces grands auteurs, extraits précédés chaque fois de quelques pages de présentation. Cette approche a le mérite d’introduire à la diversité et à la pluralité de la tradition libérale mais, tributaire du choix inévitablement subjectif présidant à la sélection desdits extraits, elle s’avère très parcellaire.
Une troisième série de livres comprend ceux dont l’auteur adopte une perspective critique sur le libéralisme. De qualité très variable, ils sont tellement nombreux qu’ils constituent un genre littéraire à part entière. Il n’en manque jamais sur les tables présentant les nouveautés en librairie. La plupart, d’une trame assez convenue, sont des réquisitoires contre les méfaits supposés de l’application de la doctrine libérale. A quelques exceptions près, ces critiques donnent du libéralisme une vision tout à la fois caricaturale, erronée et injuste. Même les travaux académiques consacrés à la question témoignent souvent d’une ignorance préoccupante de leur objet d’étude. Quoiqu’il en soit, dans les rares cas où la critique est documentée et conceptuellement bien charpentée, elle est rarement adéquate pour celui qui désire prendre connaissance du contenu de la doctrine libérale en tant que telle.
Le pari tenté ici est différent. Il ambitionne de restituer la profondeur, la densité et la saveur de certaines oeuvres majeures de la tradition libérale. Il s’enracine dans la conviction suivante : il vaut mieux s’adresser à Dieu qu’à ses saints. En effet, un grand auteur écrit souvent de manière plus claire, plus vivante, plus convaincante (et même plus amusante) que les intellectuels qui vulgarisent ses idées. Le problème, c’est que, pour la plupart d’entre nous, le temps et la motivation font défaut pour lire ces ouvrages quelques peu intimidants.
Concrètement, la méthodologie adoptée par Corentin de Salle consiste à sélectionner quelques oeuvres incontournables de la tradition libérale et à les résumer en combinant deux objectifs : la synthèse et la fidélité.
La synthèse exclut que l’on suive l’auteur dans les moindres linéaments de sa pensée ou que l’on rende compte de l’ensemble de ses développements. Il ne s’agit pas de dupliquer ou de paraphraser mais de saisir la quintessence d’un argument, d’une idée, d’un concept, d’un raisonnement et d’une théorie sans jamais néanmoins sacrifier la complexité de ces derniers. La fidélité exige que l’on restitue les thèses de l’ouvrage dans la dynamique qui est la leur, c’est-à-dire en faisant état de l’analyse qui leur donne naissance, des implications qui en résultent et des prolongements qu’elles appellent. Cela nécessite aussi d’évoquer les réponses aux objections potentielles que l’auteur a pu anticiper et de préciser la délimitation du champ où la thèse s’applique. Il faut également veiller à la cohérence de l’ouvrage : les thèses se déploient et s’articulent au gré d’une pensée qui chemine et dont il faut signaler les différentes étapes sans en omettre aucune. C’est pourquoi le contenu de chaque ouvrage synthétisé est présenté chapitre par chapitre.
Ce souci extrême de fidélité vise à faire sentir le style propre de l’auteur et à faire goûter la saveur de son oeuvre. On utilise son vocabulaire, on se calque sur les mouvements de sa démonstration, on reprend certaines de ses illustrations, on conserve, par endroits, le ton humoristique et, au moyen de fréquentes citations, on permet au lecteur de savourer l’élégance de ses tournures. Cet exercice nécessite une neutralité de principe par rapport à l’oeuvre restituée. Hormis quelques qualificatifs laudateurs visant à signaler, ici et là, l’importance et la valeur d’un ouvrage dans le domaine de la pensée, on s’abstient de tout développement personnel ou de toute analyse critique.
Le travail réalisé ici est loin d’être négligeable : pas moins de douze traités majeurs de libéralisme se trouvent synthétisés et présentés de façon claire, vivante et aérée, soit près de 4000 pages de doctrine de la plus pure et de la plus haute tradition libérale. Cette tradition intellectuelle correspond à une pratique séculaire en perpétuelle évolution : elle est mouvante. Elle a été théorisée par des hommes vivant en divers lieux et à diverses époques : elle est plurielle. Les auteurs représentatifs de cette tradition se retrouvent sur l’essentiel, mais divergent sur plusieurs points. On verra que les principes de cette tradition sont conçus comme décrivant et structurant des phénomènes très concrets (structure du système scolaire, patentes, discrimination, balance des payements, politique de la concurrence, etc.). En effet, cette tradition est empirique. C’est-à-dire qu’elle se construit sur base de l’expérience vécue des hommes et s’y adapte en permanence. Elle identifie et généralise les pratiques qui fonctionnent, qui ont fait leur preuve (dans les domaines économique, politique, social, etc.).
On comprend dès lors pourquoi, contrairement à ce qu’on affirme souvent, le libéralisme n’est pas une idéologie. C’est une doctrine. Elle n’est pas figée. Elle n’est pas dogmatique. Elle n’est pas née arbitrairement dans quelques cerveaux d’intellectuels désireux d’édifier une société utopique. Elle vise plutôt à généraliser de bonnes pratiques découvertes un peu au hasard et au fil du temps. Mais ces bonnes pratiques ont en commun de résulter d’actions d’individus libres opérant dans une société d’égalité de droits. Les valeurs fondamentales du libéralisme conditionnent l’existence, la perpétuation et l’évolution de ces dernières. Cela signifie que, contrairement aux idéologies comme le communisme ou le socialisme révolutionnaire, la doctrine libérale ne vise pas à imposer sa loi à la réalité. Elle entend promouvoir et protéger ces bonnes pratiques inhérentes à une société libre contre les réglementations abusives et uniformisatrices qui menacent de réduire voire d’étouffer, dans de multiples secteurs, la liberté d’hommes et de femmes qui conditionne précisément l’invention de ces pratiques novatrices.
Cet ouvrage vise avant tout à inciter à redécouvrir cette tradition d’une exceptionnelle richesse. En effet, les auteurs libéraux ne figurent jamais ou quasiment jamais au programme des institutions d’enseignement supérieur et universitaire. Tout se passe souvent comme si cette tradition était inexistante. Beaucoup d’intellectuels se contentent d’ironiser sur la fameuse main invisible d’Adam Smith. Pourtant, la doctrine libérale repose sur un champ de connaissances très riche, très diversifié et très actuel. Les disciplines mobilisées dans ces traités sont diverses et complexes. Il y est question d’anthropologie, d’épistémologie, de psychologie, de sociologie, de philosophie morale et politique, de théorie du droit et de science politique, économique et monétaire.
Le propos général ne se limite pas au terrain des idées. Ce qui se dégage de tous ces textes, c’est aussi une éthique d’une remarquable cohérence. Cette éthique humaniste fait du respect des droits d’autrui le fondement de toute société. Il n’est pas inutile de comprendre en profondeur cette éthique plutôt que de se contenter d’invoquer des valeurs de manière mécanique. En effet, les adversaires du libéralisme recourent systématiquement au registre moral pour mettre le libéralisme sur la sellette. Les libéraux n’ont aucune raison de craindre de les affronter concrètement dans ce domaine. Encore faut-il qu’ils connaissent suffisamment l’éthique libérale plutôt que de tenter de se dédouaner en reprenant la rhétorique de l’accusateur. Cela leur permet d’ailleurs, à eux aussi, d’attaquer le discours adverse sur le plan de la morale. Sur ce point aussi, le présent ouvrage constitue un instrument appréciable.
Depuis bientôt cinq ans, Corentin de Salle est mon collaborateur au centre d’étude et à la présidence du parti. Homme de conviction, il s’occupe de questions sociétales très diverses et y apporte toujours un éclairage doctrinal permettant de dégager les principes et les valeurs sur lesquels appuyer projets et propositions de loi.
Je tiens à remercier tout particulièrement le Forum Libéral Européen, qui assure l’édition du présent ouvrage, ainsi que le Parlement européen pour son soutien financier. Je remercie également les collaborateurs du Centre Jean Gol pour les relectures du manuscrit et les remarques qui ont amélioré son contenu.



