Dans cette interview pour 21 News, le directeur scientifique du Centre Jean Gol Corentin de Salle analyse en profondeur la récente victoire électorale du Mouvement Réformateur. Il dévoile les clés stratégiques de ce succès, le rôle déterminant joué par le Centre Jean Gol, et partage sa vision pour l’avenir du libéralisme en Belgique.
Lisez ici l’intégralité de l’interview de Corentin de Salle pour 21 News en accès libre.
Comment analysez-vous la victoire du MR aux dernières élections ?
Quand on écoute les commentateurs patentés, on entend beaucoup d’explications. Mais, elles ne me satisfont pas.
On a coutume de prendre la question à l’envers : ce n’est pas le MR qui a gagné mais la gauche qui a perdu. Posons-nous la question : pourquoi les partis de gauche ont-ils perdu ? Beaucoup de facteurs expliquent cette défaite. Je ne vais pas en faire la liste ici car cela nous entraînerait trop loin. Je ne vais pas parler de l’absence de programme du PS, de la politique incohérente de Paul Magnette et de la désolante radicalisation de son parti dans une course à l’échalotte avec le PTB. Je ne vais pas parler de la stérile dérive communautariste d’Ecolo, de l’agacement de la classe moyenne suscité par l’écologie punitive, du désastreux plan Good Move et de la monumentale erreur de jugement qu’a été le détricotage de la réforme du décret paysage par Ecolo et le PS.
 Même si la gauche a fortement régressé, la victoire du MR ne résulte pas de l’échec de la gauche par un jeu de vases communicants. En réalité, le parti qui a le plus bénéficié du report de voix de la gauche, c’est les Engagés : en dépit d’un programme plutôt flou, il a littéralement pompé les voix d’Ecolo. Au contraire, si le MR a gagné, c’est plus en raison de ses mérites propres : il a progressé de manière remarquable.
Même si la gauche a fortement régressé, la victoire du MR ne résulte pas de l’échec de la gauche par un jeu de vases communicants. En réalité, le parti qui a le plus bénéficié du report de voix de la gauche, c’est les Engagés : en dépit d’un programme plutôt flou, il a littéralement pompé les voix d’Ecolo. Au contraire, si le MR a gagné, c’est plus en raison de ses mérites propres : il a progressé de manière remarquable.
On pourrait ensuite – c’est une explication très répandue dans la gauche – expliquer cela par un mouvement structurel qui fait que la droite remonterait un peu partout en Europe et dans le monde. Le MR serait, selon cette hypothèse, bénéficiaire d’un mouvement structurel. Mais si c’était vrai, pourquoi la gauche radicale a-t-elle tellement percé en France aux dernières élections ? Pourquoi, inversement, le VLD, autre parti libéral, s’est-il à ce point écrabouillé ?
On me dira alors que ce mouvement structurel a fait le jeu des extrémismes. C’est faux. D’une part, le PTB et le VB n’ont pas fait le raz de marée prédit par le commentateurs (et notamment le matin même de l’élection par l’immense politologue Pascal Delwit qui s’est magistralement planté dans ses calculs). D’autre part, si vous examinez le positions et les déclarations du MR en campagne, vous verrez qu’elles n’étaient ni populistes ni extrémistes. Son programme n’était pas racoleur mais clair et cohérent. Contrairement aux partis de gauche, il ne promettait pas des aides, des subsides et la gratuité dans tous les domaines mais était axé avant tout sur la valeur travail, sur le mérite et la fierté d’être libéral.
La victoire – ou plutôt le triomphe du MR – résulte, selon moi, de plusieurs facteurs. J’en vois au moins trois.
Premièrement, un travail acharné et de longue haleine sur le terrain, notamment à Bruxelles sur les marchés et dans le porte à porte. David Leisterh et son équipe ont vraiment fait un travail de reconquête. En Wallonie, nos candidats ont également écumé les campagnes et les grands villes.
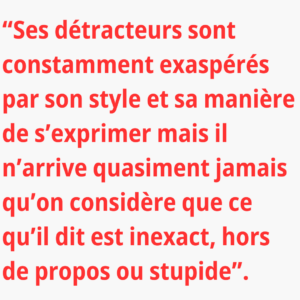 Deuxièmement, il faut souligner l’intrépidité, l’ossature idéologique, le sens stratégique et la personnalité hors normes du président du MR qui suscite au moins autant l’adhésion que le rejet. Un président qui, des années durant, a été considérablement sous-estimé par ses ennemis mais également, au sein même de son parti, par plusieurs de ses barons. Ses détracteurs sont constamment exaspérés par son style et sa manière de s’exprimer mais il n’arrive quasiment jamais qu’on considère que ce qu’il dit est inexact, hors de propos ou stupide. On ne le reprend quasiment jamais sur le contenu de ce qu’il affirme. Car, la réalité est qu’il maîtrise ses dossiers en profondeur. Il est quotidiennement informé sur ces derniers par ses collaborateurs. Le plus souvent via des échanges whatsapp assez succincts.
Deuxièmement, il faut souligner l’intrépidité, l’ossature idéologique, le sens stratégique et la personnalité hors normes du président du MR qui suscite au moins autant l’adhésion que le rejet. Un président qui, des années durant, a été considérablement sous-estimé par ses ennemis mais également, au sein même de son parti, par plusieurs de ses barons. Ses détracteurs sont constamment exaspérés par son style et sa manière de s’exprimer mais il n’arrive quasiment jamais qu’on considère que ce qu’il dit est inexact, hors de propos ou stupide. On ne le reprend quasiment jamais sur le contenu de ce qu’il affirme. Car, la réalité est qu’il maîtrise ses dossiers en profondeur. Il est quotidiennement informé sur ces derniers par ses collaborateurs. Le plus souvent via des échanges whatsapp assez succincts.
On en arrive à la troisième raison de la victoire : un programme clair, audacieux, cohérent et novateur. Et, derrière cela, se profile le rôle méconnu du Centre Jean Gol et de ses collaborateurs.
Justement, quel a donc été le rôle du Centre Jean Gol dans la campagne électorale ?
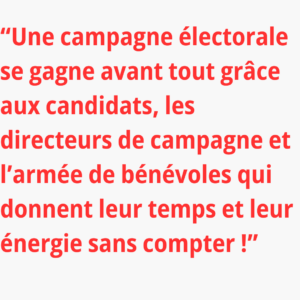 Une campagne électorale se gagne avant tout grâce aux candidats, les directeurs de campagne et l’armée de bénévoles qui donnent leur temps et leur énergie sans compter ! Elle se gagne aussi avec un capitaine – le président du MR – et une vision de société qui doit être innovante, disruptive et, surtout, absolument claire et cohérente au niveau des valeurs.
Une campagne électorale se gagne avant tout grâce aux candidats, les directeurs de campagne et l’armée de bénévoles qui donnent leur temps et leur énergie sans compter ! Elle se gagne aussi avec un capitaine – le président du MR – et une vision de société qui doit être innovante, disruptive et, surtout, absolument claire et cohérente au niveau des valeurs.
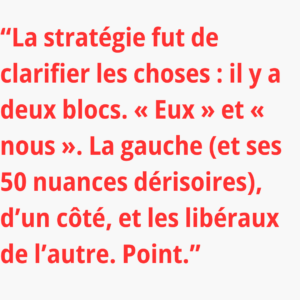 Très en amont de la campagne, un choix clair a été posé par le président : celui de la rupture avec la gauche. Avouons que le gouvernement Vivaldi, en dépit de l’action extrêmement méritoire de plusieurs ministres MR (notamment lors de la crise Covid et sur le dossier nucléaire), n’a pas accouché de grand-chose. Que de temps perdu en matière fiscale et en politique énergétique ! Le MR a du bloquer quantité de choses qui étaient inacceptables, au risque de passer pour un parti de « participe-opposition ». Dès lors, la stratégie fut de clarifier les choses : il y a deux blocs. « Eux » et « nous ». La gauche (et ses 50 nuances dérisoires), d’un côté, et les libéraux de l’autre. Point.
Très en amont de la campagne, un choix clair a été posé par le président : celui de la rupture avec la gauche. Avouons que le gouvernement Vivaldi, en dépit de l’action extrêmement méritoire de plusieurs ministres MR (notamment lors de la crise Covid et sur le dossier nucléaire), n’a pas accouché de grand-chose. Que de temps perdu en matière fiscale et en politique énergétique ! Le MR a du bloquer quantité de choses qui étaient inacceptables, au risque de passer pour un parti de « participe-opposition ». Dès lors, la stratégie fut de clarifier les choses : il y a deux blocs. « Eux » et « nous ». La gauche (et ses 50 nuances dérisoires), d’un côté, et les libéraux de l’autre. Point.
Une fois ce choix posé, il fallait proposer une vision radicalement différente. Une vision enthousiasmante. Et c’est là que le centre d’étude a pu jouer un rôle important à travers la production d’une multitude d’études. Un plaidoyer clair pour la prolongation du nucléaire et pour une révolution énergétique. Un plaidoyer pour le progrès. Un plaidoyer pour les avions et les aéroports. Pour l’industrie lourde et le port d’Anvers. Un plaidoyer pour l’agriculture plurielle et contre une politique européenne destructrice de la ruralité. Un plaidoyer contre le 100% renouvelable en Europe. Un plaidoyer pour la croissance économique, pour l’entreprenariat, pour l’industrie. Un plaidoyer pour l’autonomie stratégique. Un plaidoyer pour le droit d’Israël à se défendre. Un plaidoyer contre tous les discours de la décroissance. Un plaidoyer contre la tyrannie des minorités, contre le wokisme, contre l’écriture inclusive, contre le féminisme intersectionnel, contre la repentance, contre la détestation de soi-même. Un plaidoyer contre la restitution des biens du musée de Tervuren. Un plaidoyer contre la transition des mineurs. Etc. Toutes ces lubies suicidaires, la gauche a sauté dedans à pieds joints. Et nous nous y sommes toujours opposés, au risque de déplaire.
Mais nous avons aussi beaucoup construit et avons exploré quantité de niches : le travail, le pouvoir d’achat, la sécurité, l’enseignement, la protection des policiers, l’aggravation des peines, des moyens efficaces pour lutter contre le trafic de drogue et la grande criminalité au niveau financier, la répression de l’apologie du terrorisme, la consécration du statut des artistes, l’ébauche d’un statut des gameurs, la « silver economie », un projet de maisons de retraite plus démocratique et moins infantilisant pour les seniors, la règlementation des cryptomonnaies, la lutte contre les assuétudes, l’encadrement de l’intelligence artificielle, les nouvelles techniques génomiques, etc. A chaque fois, nous avons rencontré des spécialistes et touché quantité de personnes.

Mais toutes ces idées seraient demeurées relativement confidentielles si elles étaient restées cantonnées dans les études du Centre Jean Gol et ses lecteurs assidus. Ce qui a permis de faire percoler ces idées dans la population mais aussi de les tester et de les recalibrer, ce sont les conférences Libres Débats et les conférences Belgium 2030. Certes, ce n’est pas la première fois qu’un président du MR organise des conférences. C’est même plutôt la norme. Mais celles que nous avons organisées durant les 3 dernières années précédant les élections différaient radicalement des autres sur au moins 3 points : leur fréquence, leur professionnalisme et leur structure.
Leur fréquence d’abord car il ne s’agissait pas de faire 10 ou 15 conférences par an mais, comme le désirait le président, une bonne cinquantaine au minimum. Un peu partout en Wallonie et à Bruxelles. En gros, cela faisait une ou deux conférences par semaine avec toute la logistique (camionnettes, sonos, caméras, personnel, etc.) que cela implique.
Professionnalisme ensuite : la période du Covid a contraint le MR de communiquer fréquemment via des caméras, d’organiser des « live », de planifier des formats de temps de paroles, de réaliser des petites vidéos introductives aux conférences, d’acheter et d’utiliser du matériel de pointe, de rediffuser à grande échelle des captations, de nourrir par la suite les réseaux sociaux avec des capsules vidéos reprenant les meilleures répliques, etc. Les conférences organisées physiquement dans quantité de lieux (centres culturels, maisons communales, salles de sport, hautes écoles, etc.) ont pu bénéficier de ce matériel et de ce savoir-faire acquis au fil du temps. Au point d’en faire une machine parfaitement huilée avec des conférences qui ressemblaient plus à des émissions de télé qu’à des conférences classiques. Fini la succession des orateurs occupant le perchoir durant une demie heure. Ici, on était dans des interactions dynamiques avec un présentateur tendant le micro à des orateurs assis dans des fauteuils pour des répliques de 4 à 5 minutes. Le tout suivi par plusieurs tours de question émanant de la salle.
 Structure enfin : il s’agissait ici clairement de construire le programme et de tester les idées du centre d’étude et de ses conseillers. Le président voulait, outre lui-même, au moins 3 ou 4 professeurs d’université et parmi eux, au moins, un ou deux orateurs à gauche voire très à gauche pour qu’il y ait débat, dispute , confrontation. Bref, du spectacle. Ce ne fut pas une mince affaire de trouver chaque semaine des professeurs d’université acceptant, un jour de semaine, de se déplacer à Virton, Marche en Famenne, La Roche en Ardenne ou Verviers. Il fallait en contacter au moins le quadruple pour arriver à constituer des panels. Sans compter les conférences grands formats où nous faisions venir des orateurs français de grande renommée. Mais cela nous a permis de diversifier nos carnets d’adresse, nos contacts et aussi notre réseau d’experts.
Structure enfin : il s’agissait ici clairement de construire le programme et de tester les idées du centre d’étude et de ses conseillers. Le président voulait, outre lui-même, au moins 3 ou 4 professeurs d’université et parmi eux, au moins, un ou deux orateurs à gauche voire très à gauche pour qu’il y ait débat, dispute , confrontation. Bref, du spectacle. Ce ne fut pas une mince affaire de trouver chaque semaine des professeurs d’université acceptant, un jour de semaine, de se déplacer à Virton, Marche en Famenne, La Roche en Ardenne ou Verviers. Il fallait en contacter au moins le quadruple pour arriver à constituer des panels. Sans compter les conférences grands formats où nous faisions venir des orateurs français de grande renommée. Mais cela nous a permis de diversifier nos carnets d’adresse, nos contacts et aussi notre réseau d’experts.
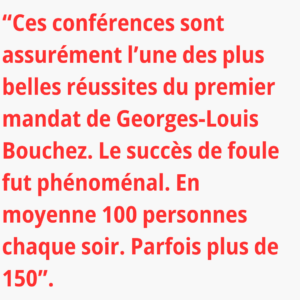 Ces conférences sont assurément l’une des plus belles réussites du premier mandat de Georges-Louis Bouchez. Le succès de foule fut phénoménal. En moyenne 100 personnes chaque soir. Parfois plus de 150. Cela se terminait généralement après minuit car la conférence continuait avec des gens, généralement des jeunes, faisant cercle autour du président. Le dernier à sortir était le président lui-même quand le concierge décidait enfin de l’expulser.
Ces conférences sont assurément l’une des plus belles réussites du premier mandat de Georges-Louis Bouchez. Le succès de foule fut phénoménal. En moyenne 100 personnes chaque soir. Parfois plus de 150. Cela se terminait généralement après minuit car la conférence continuait avec des gens, généralement des jeunes, faisant cercle autour du président. Le dernier à sortir était le président lui-même quand le concierge décidait enfin de l’expulser.
En résumé, ces conférences ont réellement joué un rôle évangélisateur. Elles ont permis au Centre d’étude de recueillir de précieux feedback pour ses idées et d’obtenir une amélioration et une validation implicite par les professeurs d’université et experts de toutes tendances idéologiques. Ce fut assurément une des clés de la victoire.
 Comment décririez-vous l’évolution du Centre Jean Gol depuis quelques années ?
Comment décririez-vous l’évolution du Centre Jean Gol depuis quelques années ?
Ce qui a fort changé au Centre Jean Gol depuis l’accession à la présidence de Georges-Louis Bouchez, c’est principalement deux choses.
Premièrement, la volonté du président d’exploiter politiquement la production intellectuelle du centre d’étude. Auparavant, il était rare qu’un président convoque des journalistes pour présenter les éléments, conclusions et propositions d’une étude. Rare également que des études fassent autant le buzz, scandalisent et créent autant la polémique dans la presse et dans les autres partis. Cela a permis au parti d’assurer un leadership dans la production du débat citoyen car les autres partis se cantonnaient passivement dans l’indignation, la réaction et la critique.
Deuxièmement, nous avons, grâce au renforcement massif et au rajeunissement de l’équipe de la communication du MR réussi à créer une véritable synergie entre ce service et le Centre Jean Gol. Avant, la « com » et le centre d’étude fonctionnaient un peu en vase clos. A mon grand désespoir. Certes, la com nous aidait mais assurait la plupart du temps un service minimum quand il s’agissait de visibiliser les activités du Centre. Si un ouvrage sortait, on avait droit à 2 paragraphes sur les réseaux sociaux, une news sur le site MR, un mail à quelques contacts, etc. J’ai eu la chance de pouvoir tisser quantité de liens avec les membres de la nouvelle équipe et le président y était très favorable. Ajoutons que ce dernier nous a demandé d’assurer une production quasiment quotidienne de contenus sur les réseaux sociaux du Centre d’étude en restant attentif aux plus petits détails. La « com » nous a appris à communiquer de manière plus succincte, plus fréquente, plus professionnelle. Et je pense que le CJG a rendu la com plus substantielle sur le fond, plus pertinente, plus audacieuse, et moins conformiste. Il y a une fertilisation mutuelle.
Le Centre Gol va être renforcé a annoncé Georges-Louis Bouchez, quels sont vos projets pour l’avenir ?
Nous aimerions intensifier nos activités actuelles en terme de publications (analyses, notes, études, ouvrages, etc.) et les diffuser à un public encore plus étendu, notamment via de petites capsules vidéos des auteurs qui en présentent les idées principales afin de les faire connaître et inciter davantage à les lire. Certaines de nos études font le buzz mais cela ne représente même pas 5% de ce que nous produisons annuellement. Il y a donc un grand patrimoine de documents de grande qualité sur quantité de problèmes sociétaux à faire découvrir et à partager.

Nous désirons aussi continuer à organiser des conférences de haut niveau sur des sujets sensibles. Il existe déjà des clubs, des cercles d’entreprises, des fondations, des universités organisant quantité de conférences sur quantité de sujets et c’est une excellente chose. Le Centre Jean Gol est surtout là pour aborder de manière pluraliste des sujets considérés comme controversés voire tabous mais qui nécessitent une solution politique ou législative. Avec, si possible, des orateurs de renommée internationale. Notre but, je dirais même notre vocation, est de déverrouiller le débat public sur les sujet sensibles et de trouver ensemble les solutions nécessaires pour améliorer les choses.
Une question qui se pose également est l’opportunité de créer un volet flamand du Centre Jean Gol. Qui publierait des études traduites en flamand. Cela permettrait aussi de fédérer de nombreux experts et professeurs d’université des universités flamandes. Il n’y a plus vraiment de centres d’études politiques libéraux dignes de ce nom en Flandre. Il y a un marché à pendre. Le VLD est en crise. Et la N-VA, on le voit dans les négos aujourd’hui – avec sa complaisance envers les exigences collectivistes de Vooruit – n’est plus le défenseur des idées libérales dans le secteur socio-économique. Je n’aurais jamais cru cela de la Flandre il y a 5 ans. A nous de reprendre le flambeau libéral flamand tombé dans la rigole.
Je pense également important d’étendre notre influence au sein des centres d’études libéraux des partis européens. Nous avons été parmi les 3 ou 4 centres d’études fondateurs, il y a 15 ans, de l’European Liberal Forum, regroupant les centres d’études libéraux rattachés à des partis politiques. Nous sommes plus de 50 aujourd’hui. Lors des dernières élections européennes, nous fûmes un des rares partis libéraux à augmenter le nombre de nos députés au sein du parlement européen. Cela nous confère, au sein de cette instance, une légitimité et une crédibilité accrues. Si nos moyens sont renforcés, j’aimerais pouvoir m’investir davantage à ce niveau de pouvoir. Sur au moins 3 dossiers : l’autonomie stratégique, la réindustrialisation et l’écologie libérale.
Il y a quelques jours, dans les colonnes du Soir, le professeur Edouard Delruelle, étiqueté socialiste, déplorait que le Centre Jean Gol était « en train de gagner la bataille culturelle ». De quoi s’agit-il ?
(Rires). J’aimerais le croire mais nous ne sommes qu’au début. Nous avons gagné une première manche mais la bataille est devant nous. Je ne vais pas expliquer ici la signification et l’histoire de ce concept anglo-saxon de « bataille culturelle » (ou « cultural war ») sur lequel quantité de livres et thèses de doctorat ont été écrits. Disons que, depuis quelques décennies en Belgique (mais également en France), les intellectuels de gauche ont occupé une position hégémonique. C’est-à-dire qu’ils ont longtemps été la force qui impose la grille de lecture des phénomènes et évènement au sein d’une société. Ils imposaient même la sémantique (« justice sociale », « inclusion », « démocratie participative », « bain de sang social », « neutralité inclusive », « précarité étudiante », « durabilité », « vivre-ensemble », « accommodements raisonnables », etc., etc.). Cette grille de lecture, ils arrivaient à l’imposer à la presse, au monde associatif, au monde académique, aux partis de gauche et même aux membres de notre propre parti. Cela leur a conféré une puissance d’influence gigantesque car, on pense avec les mots. Quand vous maîtrisez le vocabulaire, disait Napoléon, vous maîtrisez les gens. Mais tout cela est en train de s’écrouler ces derniers mois et c’est quelque chose de passionnant. Car nous entendons désormais imposer une nouvelle grille de lecture, libérale cette fois, en prenant le lead dans quantité de domaines (écologie libérale, IA, digitalisation, travail, fiscalité, sécurité, sécurité sociale, politique énergétique, politique culturelle, etc.). Pas pour forcer évidemment les gens à penser comme on le leur demanderait : rien n’est plus contraire à nos convictions libérales. Mais pour mettre en avant nos idées et nos propositions et continuer à en débattre.
Le Soir vous accuse d’unilatéralisme et relaie les propos de Pascal Delwit qui qualifie votre formation de « droite radicale ». Que répondez-vous ?
Je réponds que le premier reproche est totalement inexact et que la qualification de Pascal Delwit est ridicule et probablement intellectuellement malhonnête voire malveillante. Premièrement, tous ceux qui assistent aux conférences du Centre Jean Gol (et on en organisé plus de 150 ces trois dernières années) et tous ceux qui lisent les analyses et études de notre centre savent que le CJG est profondément attaché à la culture du débat et au pluralisme. Nous nous employons à inviter systématiquement des experts et intellectuels qui ne pensent pas comme nous. Le président est très friand de ce genre de débats. C’est assez paradoxal de nous adresser ce reproche car je ne pense pas qu’il y ait une seule formation politique qui invite autant de gens appartenant à d’autre familles politiques. Par ailleurs, du côté des autres partis de gauche, c’est la culture de l’entre-soi. Je ne me souviens pas avoir jamais été invité à une conférence organisée par un parti de gauche. Alors que chez nous, c’est monnaie courante. Nous avons invité Di Rupo le mois passé. Nous avons déjà invité quantité de fois la FGTB. Son président est déjà venu parler au siège du MR sous l’égide du Centre Jean Gol…
Je constate par ailleurs que la grande spécialité de la gauche, c’est, dès l’annonce d’une de nos conférences, de critiquer la composition du panel. « Pas assez de femmes ». « Pas assez de telle ou elle minorité (ethnique, sexuelle, etc.) ». « Pas assez de gens de terrain ». « Pas assez d’experts ». « Un tel ou une telle ne mérite pas d’être dans le panel pour telle ou telle raison ». « Pourquoi ne pas avoir invité tel ou tel ? ». Comme si nous devions nous en référer à eux pour savoir qui est acceptable de prendre la parole. Le monde à l’envers. Je ne me souviens pas d’avoir jamais examiné le panel des conférences organisées par la gauche et leur avoir adressé des reproches. J’ai autre chose à faire. On peut dresser un axiome : « quel que soit le panel choisi, toujours tu seras critiqué ». C’est comme la fable de Lafontaine avec « le meunier, son fils et l’âne » : quoi qu’on fasse, il y aura toujours de gens pour vous le reprocher. J’ai d’ailleurs parfois l’impression que ces gens qui nous reprochent cela ne portent généralement absolument aucun intérêt sur la conférence en tant que telle et son contenu. Tout ce qui importe est de savoir si les intérêts de tel ou tel groupe seront suffisamment représentés. Et ce n’est évidemment jamais le cas à leurs yeux.
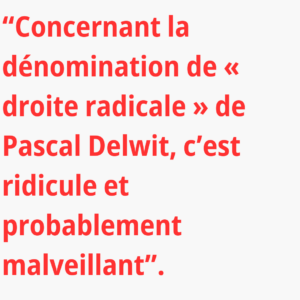 Concernant la dénomination de « droite radicale » de Pascal Delwit, c’est ridicule et probablement malveillant. Ridicule car notre formation est libérale dans son ADN et tout, dans son programme, nos campagnes électorales, nos publications et déclarations, atteste de notre fidélité à cette doctrine politique. Au niveau du positionnement, le MR est de centre-droit. Sur l’échiquier politique en Fédération Wallonie-Bruxelles, le MR est effectivement situé à droite des autres formations. Nous avons, comme je l’ai dit, joué, en pré-campagne, sur notre opposition à la gauche. Mais il y a une formation d’extrême droite sur notre droite, quoique électoralement insignifiante. Rappelons qu’en avril, mai, juin 2024, nous étions concurrencé, sur notre droite, par la N-VA. Je précise aussi que, sur le plan éthique, nous sommes, sur certains dossiers, moins à droite que les Engagés. Nous sommes favorables à un allongement de la durée où l’avortement est possible. Nous avons voté pour la loi transgenre. Etc. Parler de « droite radicale » est ridicule. Une droite radicale aurait-elle confié à une femme d’origine algérienne le ministère fédéral des affaire étrangères (le plus important après celui de Premier ministre) ou un poste de Commissaire Européen ? Une « droite radicale » aurait-elle désigné une femme première ministre, la toute première dans l’histoire belge ? Quand vous demandez à quelqu’un ce qui, précisément, dans le programme du MR, attesterait qu’il agit d’un parti de droite radicale, d’extrême droite, de droite raciste, etc., il est systématiquement incapable de répondre. Il va, dans le meilleur des cas, trouver une vague citation déformée du président tirée de son contexte et à laquelle il va conférer une signification fantaisiste.
Concernant la dénomination de « droite radicale » de Pascal Delwit, c’est ridicule et probablement malveillant. Ridicule car notre formation est libérale dans son ADN et tout, dans son programme, nos campagnes électorales, nos publications et déclarations, atteste de notre fidélité à cette doctrine politique. Au niveau du positionnement, le MR est de centre-droit. Sur l’échiquier politique en Fédération Wallonie-Bruxelles, le MR est effectivement situé à droite des autres formations. Nous avons, comme je l’ai dit, joué, en pré-campagne, sur notre opposition à la gauche. Mais il y a une formation d’extrême droite sur notre droite, quoique électoralement insignifiante. Rappelons qu’en avril, mai, juin 2024, nous étions concurrencé, sur notre droite, par la N-VA. Je précise aussi que, sur le plan éthique, nous sommes, sur certains dossiers, moins à droite que les Engagés. Nous sommes favorables à un allongement de la durée où l’avortement est possible. Nous avons voté pour la loi transgenre. Etc. Parler de « droite radicale » est ridicule. Une droite radicale aurait-elle confié à une femme d’origine algérienne le ministère fédéral des affaire étrangères (le plus important après celui de Premier ministre) ou un poste de Commissaire Européen ? Une « droite radicale » aurait-elle désigné une femme première ministre, la toute première dans l’histoire belge ? Quand vous demandez à quelqu’un ce qui, précisément, dans le programme du MR, attesterait qu’il agit d’un parti de droite radicale, d’extrême droite, de droite raciste, etc., il est systématiquement incapable de répondre. Il va, dans le meilleur des cas, trouver une vague citation déformée du président tirée de son contexte et à laquelle il va conférer une signification fantaisiste.
Pour un politologue comme Pascal Delwit, c’est gravissime et irresponsable de débiter des bêtises pareilles. Il se dépouille ici de toute neutralité scientifique. C’est probablement malveillant. Je n’en sais rien. Je ne suis pas dans la tête de Pascal Delwit. Peut-être pense-t-il réellement que la gauche (à laquelle il appartient, c’est son droit), est méthodologiquement le point neutre en politique autour duquel tout doit s’organiser.
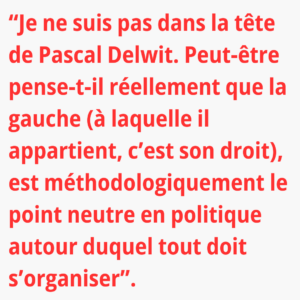 Je sais par contre qu’il ne se prive jamais d’énoncer des jugements négatifs et dénigrants sur le Centre Jean Gol, Georges-Louis Bouchez, ma personne, celle de Nadia Geerts et le MR en général. C’est probablement malveillant. On sent bien qu’il n’a pas osé utiliser le terme « extrême-droite » mais cette dénomination semble suggérer qu’on s’en approche. Il vise probablement à rendre le MR infréquentable et à semer la zizanie en son sein. Cette désignation pernicieuse de « droite radicale » vise à nous associer à la droite radicale italienne, autrichienne, etc. « Droite radicale » serait ainsi ce qui correspond, de l’autre côté du spectre politique, à la « gauche radicale » qui est le terme aujourd’hui utilisé par plusieurs politologues pour désigner le PTB quand ils ne veulent plus parler « d’extrême-gauche ». Non-sense ! Le parti démocratique auquel il faut nous opposer dans cette échelle, c’est le PS et pas le PTB. Elle vise en même temps à salir le MR et à rendre respectable le PTB. C’est peut-être aussi – qui sait ? – un service rendu au PS bruxellois qui caresse l’idée de gouverner à la région avec le PTB mais qui a besoin de placer PTB et MR sur le même pied alors que le PTB – qui refuse obstinément de condamner la violation des droits de l’homme dans quantité de pays communistes – est un parti populiste, anti-démocratique et d’essence totalitaire. Fondamentalement, je soupçonne Pascal Delwit d’être un acteur de cette guerre culturelle. Est-ce à dire que tous les moyens sont bons dans cette guerre ? Evidemment que non. Soit on parle en tant qu’expert soit on parle en tant qu’intellectuel engagé. Une « bataille » doit se mener à la loyale. En écoutant tous les points de vue. Cela a toujours été notre ligne et cela le restera.
Je sais par contre qu’il ne se prive jamais d’énoncer des jugements négatifs et dénigrants sur le Centre Jean Gol, Georges-Louis Bouchez, ma personne, celle de Nadia Geerts et le MR en général. C’est probablement malveillant. On sent bien qu’il n’a pas osé utiliser le terme « extrême-droite » mais cette dénomination semble suggérer qu’on s’en approche. Il vise probablement à rendre le MR infréquentable et à semer la zizanie en son sein. Cette désignation pernicieuse de « droite radicale » vise à nous associer à la droite radicale italienne, autrichienne, etc. « Droite radicale » serait ainsi ce qui correspond, de l’autre côté du spectre politique, à la « gauche radicale » qui est le terme aujourd’hui utilisé par plusieurs politologues pour désigner le PTB quand ils ne veulent plus parler « d’extrême-gauche ». Non-sense ! Le parti démocratique auquel il faut nous opposer dans cette échelle, c’est le PS et pas le PTB. Elle vise en même temps à salir le MR et à rendre respectable le PTB. C’est peut-être aussi – qui sait ? – un service rendu au PS bruxellois qui caresse l’idée de gouverner à la région avec le PTB mais qui a besoin de placer PTB et MR sur le même pied alors que le PTB – qui refuse obstinément de condamner la violation des droits de l’homme dans quantité de pays communistes – est un parti populiste, anti-démocratique et d’essence totalitaire. Fondamentalement, je soupçonne Pascal Delwit d’être un acteur de cette guerre culturelle. Est-ce à dire que tous les moyens sont bons dans cette guerre ? Evidemment que non. Soit on parle en tant qu’expert soit on parle en tant qu’intellectuel engagé. Une « bataille » doit se mener à la loyale. En écoutant tous les points de vue. Cela a toujours été notre ligne et cela le restera.



